Le sort des animaux de compagnie en cas de séparation du couple
Publié le 26 février 2025
En France, il existe 75 millions d’animaux domestiques pour 68 millions d’habitants répartis sur 22,9 millions de foyers, soit environ 2,5 animaux par foyer. Plus précisément, 57 % des foyers français possèdent un ou plusieurs animaux de compagnie, en majorité des chats et des chiens. Si l’on veut se souvenir qu’en 2023, 120 000 divorces ont été prononcés et y ajouter les séparations hors mariage, l’on comprend que le sort des animaux de compagnie en cas de séparation n’est plus un sujet de dissertation juridique pour étudiants de première année, mais un véritable phénomène de société. L’animal de compagnie est défini par l’article L.214-6 du Code rural comme tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. Jusqu’en 2015, le statut de l’animal domestique était plus que sommaire, mais simple à appréhender : c’était celui des meubles par nature tels que définis par l’article 528 ancien du Code civil. Constituaient ainsi des meubles par nature les animaux et les corps qui pouvaient se transporter d’un lieu à un autre. L’évolution du ressenti de la condition animale dans la société française a conduit le législateur, vraisemblablement inspiré par de nobles motifs, à modifier la loi en février 2015 pour introduire dans le Code civil l’article 515-14 qui dispose que : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.«
Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Le terme « sensibilité » a pour synonymes usuels « affectivité », « émotion », « émotivité », « réceptivité » ou encore « sensation ». À l’instar de Lamartine, qui se demandait si les objets inanimés avaient ou non une âme, l’on peut donc légitimement s’interroger sur le point de savoir si les animaux ne seraient pas des objets animés ayant une âme. C’est tout le problème posé par la nouvelle définition car la reconnaissance de la sensibilité animale sans changement du statut conduit, de fait, à une modification de leur régime en cas de dissolution du lien matrimonial, que le droit peine à définir, en l’articulant autour de certaines règles de principe qui régissent la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples mariés ou non mariés, et en tentant de pallier l’absence de statut intermédiaire entre les êtres vivants et les choses. Pour sa part, la jurisprudence donne lieu à des décisions hétéroclites, parfois cocasses ou drôles, mais aussi dramatiques, notamment pour les enfants.

I. En cas de mariage
À titre liminaire, il y lieu d’insister sur le fait qu’en cas de divorce par consentement mutuel, aucun problème n’est -a priori- susceptible de se poser puisque les parties sont supposées être d’accord sur l’ensemble des dispositions de la rupture. Si le divorce se fait par acte d’avocat, celui-ci doit prendre soin d’insérer dans la convention définitive une « clause canine ».
Il en va de même en cas d’accord des parties.
Si le rôle de l’avocat est indispensable en matière de divorce, l’expérience montre qu’il devra se transformer en médiateur lorsqu’il s’agit pour les époux de régler la question de l’attribution du chat ou du chien de la maison, tant ceux-ci font aujourd’hui partie de la famille.

Pour les autres cas de divorce, la règle appliquée repose sur un principe classique : l’attribution de l’animal dépend du régime matrimonial choisi par les époux.
Le rôle des parties a clairement été posé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 5 juin 1991, qui a estimé que « les animaux étant des meubles par nature, il appartient à l’époux, qui, après divorce, demande l’attribution d’un chien, de faire la preuve de ses droits privatifs comme sur un meuble ordinaire ».
A. En l’absence de contrat de mariage
Lorsqu’il n’y a pas de contrat de mariage, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique. Tous les biens acquis pendant le mariage sont donc réputés faire partie de la communauté, sauf à l’un ou l’autre des époux de démontrer que le bien lui est propre.
Si l’animal a été adopté ou acquis par l’un des époux avant le mariage, aucun problème ne se pose : il s’agit d’un bien propre qui devra lui être attribué.
En revanche, si l’adoption ou l’acquisition a eu lieu pendant le mariage, l’époux qui en revendique l’attribution devra produire des éléments de preuve de ce qu’il en est propriétaire, à savoir :
- Un certificat de propriété délivré par l’ICAD (Identification des Carnivores et Animaux Domestiques), s’il s’agit d’un chat ou d’un chien ;
- La facture d’achat ;
- Le certificat d’adoption ;
- Des témoignages et attestations de tiers ;
- La justification de ce que l’époux revendiquant s’est acquitté de l’ensemble des frais de soins, d’assurances, de nourriture de l’animal et peut être considéré comme propriétaire « de fait ».

En revanche, la présomption de propriété édictée par l’article 2276 du Code civil, selon lequel « en fait de meubles possession vaut titre », ne peut être utilement invoquée puisque la possession est équivoque, dans la mesure où le couple vit sous le même toit.
Si cette preuve n’est pas rapportée, et à défaut d’accord, il appartiendra au juge aux affaires familiales de procéder à l’attribution de l’animal selon les règles régissant le partage, étant observé qu’au contraire de certaines législations étrangères comme le Portugal, l’attribution préférentielle n’est pas prévue par les textes.
Toutefois, si le chat ou le chien a été reçu en cadeau, il doit être conservé par son bénéficiaire.
B. En présence d’un contrat de mariage
1. La séparation de biens
Sous ce régime, chaque époux est propriétaire individuel des biens qu’il a acquis avant et pendant le mariage. Il n’y a aucune communauté, mais au contraire deux patrimoines séparés. Chaque époux est propriétaire individuel des biens qu’il a acquis avant et pendant le mariage.
Dans ce cas, la preuve de la propriété peut être faite selon les mêmes procédés qu’en l’absence d’un contrat de mariage.
Par exemple, lorsque le chien a été acquis par l’épouse mariée sous le régime de la séparation de biens, il doit lui être attribué.
2. La communauté universelle
La communauté universelle, c’est l’inverse de la séparation de biens : tous les biens sont communs, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage, sauf les biens propres par nature. Concrètement, les époux n’ont plus aucun bien personnel, mais ils peuvent aménager la communauté universelle par l’exclusion des biens qui leur ont été donnés ou dont ils ont hérité.
Dans ce cas, l’époux qui demande que l’animal lui soit attribué devra renverser la présomption d’universalité en s’appuyant sur les moyens de preuve déjà abordés, pour démontrer qu’il en est propriétaire.

II. Hors mariage (PACS, concubinage)
A. Le PACS
L’article 515-1 du Code civil dispose que le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Le régime légal du PACS est celui de la séparation de biens, sauf indivision conventionnelle.
Par conséquent :
- Il appartiendra au partenaire revendiquant de faire la preuve de la propriété de l’animal ;
- En cas de régime indivisaire, si l’animal a été acquis ou adopté par l’un des partenaires avant l’enregistrement du PACS, il lui sera personnel ; après l’enregistrement, il fera partie de l’indivision et les questions de preuve de la propriété se soulèveront.
B. Le concubinage
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (art. 515-8 du Code civil).
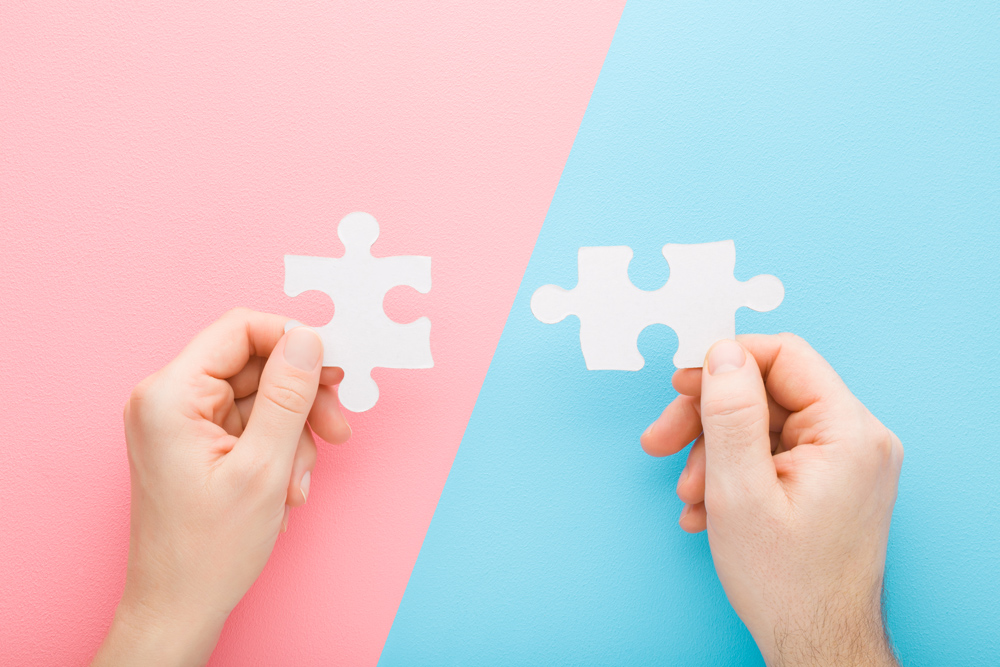
Les biens acquis par chacun des concubins restent leur propriété individuelle.
Le « régime » du concubinage est donc un régime séparatiste pur, chacun des concubins devant rapporter la preuve de la propriété de l’animal dont il sollicite l’attribution, sauf dans l’hypothèse d’un cadeau.
III. Les critères d’attribution de l’animal
La première méthode dite de la « mise en situation » n’est utilisée qu’aux Etats-Unis et n’a, fort heureusement, pas encore été importée en France.
Des avocats, dont le slogan est « You get the car, I get the cat » (« tu as la voiture, je garde le chat ») ont imaginé de placer l’animal à équidistance de ses maîtres potentiels et de le faire attribuer à celui vers lequel il se dirigerait spontanément…S’il est difficile de critiquer le côté comique de ce procédé, l’on est en droit de se poser des questions quant à son efficacité.
Dans un premier temps, les juges « aux affaires matrimoniales » ont refusé de statuer sur les demandes d’attribution des chats ou des chiens, qu’ils déclaraient irrecevables faute d’intérêt à agir, en estimant qu’elles étaient dérisoires par rapport aux autres prétentions qui leur étaient soumises.
Certains juges aux affaires familiales ont considéré qu’ils n’avaient pas le pouvoir de statuer sur l’attribution de l’animal dans le cadre du prononcé du divorce et qu’il appartenait aux époux de régler cette question entre eux dans l’attente de la liquidation de communauté.

En 1979, pourtant, une décision audacieuse du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Créteil a organisé un droit de visite et d’hébergement au profit de l’époux non gardien de l’animal et a reconnu à l‘époux gardien le droit d’obtenir une pension alimentaire.
Reste que cette décision a pu être considérée comme isolée, voire d’une portée plus que restreinte, comme émanant d’une juridiction de première instance, et que le refus de statuer sur la demande d’attribution opposé par certains tribunaux aux parties a pu conduire à des situations dramatiques ou irréversibles pour l’animal : placement en refuge ou euthanasie pure et simple.
Petit à petit, une jurisprudence disparate s’est articulée autour d’un certain nombre de critères dont la plupart ont le mérite de se garder d’assimiler l’animal aux enfants.
1. La stabilité
Selon cette première approche très simple, voire simpliste, l’animal doit être attribué à celui qui en assume la charge effective au moment du jugement.
C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel de Paris en septembre 2001, dans un célèbre arrêt dit « Platoon », dans lequel elle a considéré que la garde de l’animal devait être laissée au mari, qui était resté au domicile conjugal que l’épouse avait quitté depuis longtemps.

2. L’animal de compagnie et l’enfant
Très fréquemment, le juge va fonder sa décision sur les liens affectifs entre l’enfant et l’animal et attribuer ainsi la jouissance provisoire de ce dernier au parent chez qui l’enfant réside.
3. Le cadre de vie de l’animal après la séparation
Il s’agit d’un critère fréquemment retenu par la jurisprudence, qui dissocie le sort de l’animal de la situation de l’enfant. Il a ainsi été jugé que le fait pour un des époux de disposer d’une maison avec un jardin était davantage conforme aux besoins de l’animal qui lui serait, en conséquence, attribué.
Ce critère repose sur le bien-être de l’animal.
4. Les revenus des parties et leur disponibilité
Il est certain que la partie qui peut aménager ses horaires de travail bénéficie d’un avantage dans l’attribution de l’animal par rapport à celle dont l’emploi du temps professionnel est très chargé, surtout s’il s’agit d’un chien, qui nécessite de l’attention et du temps (promenades, dressage, etc…).
Mais la dimension financière est loin d’être négligeable, si l’on veut bien considérer que la possession d’un animal de compagnie peut générer des frais importants (alimentation, vétérinaire, assurance, accessoires…).
5. Les soins apportés à l’animal par l’une ou l’autre des parties au cours de la vie commune
Cette solution peut se déduire de l’existence de liens affectifs particuliers entre l’une des parties et l’animal.

6. Les besoins d’assistance de chacun des époux
Ce cas très particulier mérite d’être mentionné : il s’agit de l’hypothèse où l’une des parties est atteinte de cécité et nécessite l’assistance d’un chien-guide.
7. L’origine de l’animal
Il n’est pas inutile de rappeler que si l’animal a été offert par l’une des parties à l’autre, il sera attribué à cette dernière.
IV. Les solutions casuistiques : droit de visite et garde alternée
A. Le droit de visite et d’hébergement
Même s’il résulte le plus souvent d’un accord entre les parties, le droit de visite a fait l’objet de décisions qui accordent un droit de visite et d’hébergement sur l’animal à celle des parties qui n’en a pas la garde.
Mais tous les juges n’ont pas la même approche. Par exemple, il a été longtemps jugé que dans le cadre des mesures provisoires, il était abusif de réglementer, s’agissant du chien, des droits de visite et d’hébergement imaginés par une référence abusive à la législation sur l’enfance.
B. La garde alternée
1. Mise en place de la garde alternée
Dans l’immense majorité des cas, la garde alternée de l’animal de compagnie repose sur un accord entre les parties et aucun arrêt ne semble avoir été rendu sur ce point.

Si le Portugal possède un dispositif légal sur la garde alternée et qu’un projet de loi est en discussion en Espagne, rien n’est à l’ordre du jour en France.
2. Conséquences de la garde alternée
La garde alternée pose deux problèmes :
- Un problème financier, lié aux coûts engendrés par la possession de l’animal ; une compensation financière, qui ne saurait revêtir la forme d’une pension alimentaire, peut être imaginée ;
- Un problème juridique : l’animal de compagnie est un bien indivis, qui, en principe, doit être inclus dans le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; la garde alternée suppose, voire impose, un maintien de celui-ci dans une indivision conventionnelle partielle, sauf meilleur accord des ex-conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS.
On le voit, le caractère hybride du statut de l’animal de compagnie n’est satisfaisant ni pour ses maîtres, ni pour lui-même. En l’absence d’une réforme législative, la solution peut se trouver-doit se trouver, serait-on tenté de dire- dans le recours à l’article 1360 du code de procédure civile qui impose aux parties de justifier de diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, et donc à l’attribution de leur animal favori. L’article 131-1 du même code, qui permet au juge d’ordonner une médiation avec l’accord des parties, peut aussi s’avérer très utile, voire indispensable : un vétérinaire, un membre d’une association, un éducateur-éleveur ou un comportementaliste animalier ne seront jamais de trop dans la résolution d’un problème qui dépasse le simple psychodrame.
Le traumatisme que la séparation cause aux enfants en serait atténué car ils considèrent le chien ou le chat comme un véritable membre de la famille. En toute hypothèse, le ou les avocats des parties devront faire tous leurs efforts pour tenter de les concilier. En attendant, le législateur pourrait s’inspirer de la loi portugaise déjà évoquée sur la garde alternée, ou, à défaut, de l’article 615.a du Code civil suisse, qui précise qu’en cas de litige portant sur la propriété d’un animal de compagnie, le juge doit statuer en faveur de la partie « qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, offre la meilleure protection pour l’animal ». L’intérêt de ce texte est de dissocier l’enfant de l’animal, qui peut avoir tendance à lui être assimilé. Ce serait un petit pas pour le Code civil. Une immense avancée dans le quotidien des justiciables.

Besoin d'un avocat ?
Nous vous mettons en relation avec l’avocat qu’il vous faut, près de chez vous.
Prendre RDV avec un avocatPartager l'article


